5 neuromythes cliniques qui ont la peau dure
Écrit le .
Posté dans Catégories: Neuromythes.
Tags: Neuromythe et Neuropsychologie.
 Crédit photo: Montage réalisé avec Canva
Crédit photo: Montage réalisé avec Canva
Le saviez-vous? Les idées reçues au sujet du fonctionnement du cerveau et des troubles neuropsychologiques se propagent parfois comme une traînée de poudre dans la culture populaire et s’installent durablement dans la tête des gens… Les neuropsychologues qui côtoient quotidiennement leurs patients en savent quelque chose! Afin de rétablir certaines vérités, on a donc demandé à notre équipe de nous partager cinq neuromythes cliniques qu’ils rencontrent régulièrement dans leur pratique et qui ont la peau dure. Prêts à les déconstruire ensemble? C’est parti!
Qu’est-ce qu’un neuromythe?
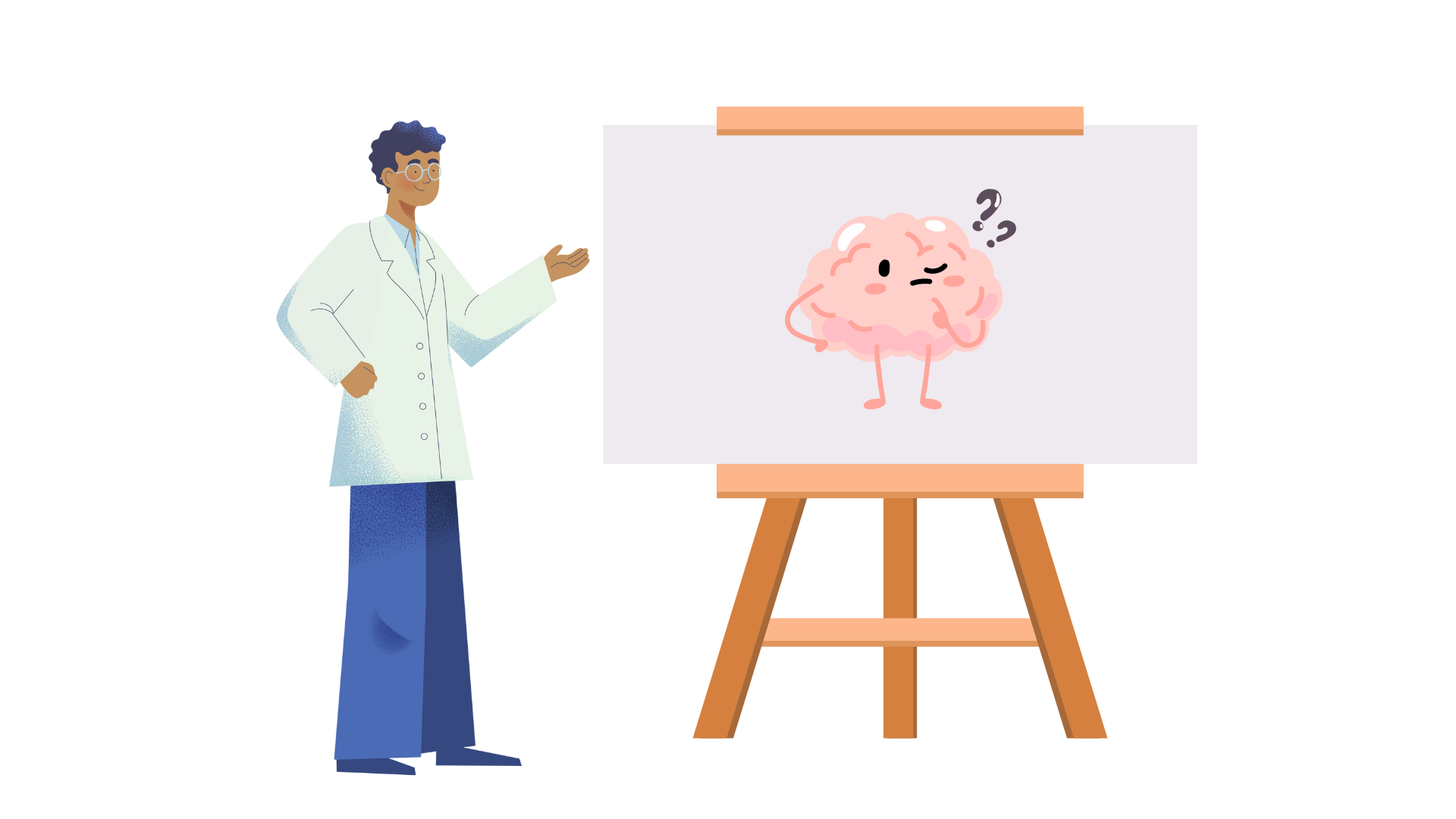
Un neuromythe est une croyance erronée sur le cerveau et sur son fonctionnement neuronal et psychologique, la plupart du temps basée sur une généralisation excessive ou une interprétation farfelue des caractéristiques du cerveau. En fait, tout part d’une mauvaise interprétation de résultats scientifiques, de la simplification excessive de concepts ou de la diffusion d’études obsolètes.
Neuromythe #1 | Donner une médication neurostimulante pour le TDAH, ça drogue les enfants
Même si plusieurs recoupements existent entre les circuits neurocognitifs impliqués dans la prise de drogues et le TDAH, ce n’est pas pour autant que les parents droguent leur enfants lorsqu’ils leur donnent des psychostimulants! En fait, le circuit neurocognitif commun aux deux est celui de la récompense, qui carbure à la dopamine. Pour augmenter l’effet de la dopamine dans ce circuit, autant les drogues de synthèse que les psychostimulants se basent sur des dérivés d’amphétamines. Or, contrairement à l’effet recherché lors de la prise de drogues de synthèse, les médicaments à base d’amphétamine vont augmenter spécifiquement l’efficacité du transport de la dopamine dans le circuit de la récompense (aussi nommé circuit de la motivation), que l’on sait être altéré par la pathologie du TDAH. En gros, avoir recours à des psychostimulants pour des personnes ayant un TDAH va permettre à leur cerveau de fonctionner plus normalement. Et pris selon la posologie indiquée, les psychostimulants ne créent pas d’accoutumance. En somme, la seule « dépendance » pour les parents pourrait être d’avoir un enfant qui fonctionne mieux à la maison, à l’école et avec ses amis, qui est plus heureux et qui développe une meilleure estime de soi!
Neuromythe #2 | Il faut un repos absolu et du noir complet après un TCC léger
De nombreuses personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC) léger se font dire de ne plus rien faire et de se plonger dans le noir jusqu’à la disparition totale des symptômes (comme la fatigue, les maux de tête, les troubles du sommeil, des problèmes de concentration ou de mémoire, une émotivité inhabituelle, etc.) Or, après un repos de 48 heures où vous maintiendrez toutefois les activités de base du quotidien, c’est vers une reprise progressive des activités, dont le travail, qu’il faudra se tourner; et ce, que vous ayez encore des symptômes ou non. Il a même été démontré dans la littérature scientifique que la reprise rapide – mais progressive – de l’exercice physique après un TCC léger aurait beaucoup de bienfaits!
Découvrez cette vidéo de l’INESSS qui vous partage des conseils pour reprendre graduellement les activités intellectuelles, physiques et sportives après 48 h de repos :
Neuromythe #3 | Les capacités cognitives révèlent le genre d’une personne
Qui n’a pas déjà entendu des phrases du genre « les hommes ont un meilleur sens de l’orientation », ou encore « les femmes sont plus sensibles aux émotions »? En fait, le genre de la personne n’a pas du tout le rôle que nous pensions jadis qu’il avait sur les fonctions cognitives! Si le cerveau des hommes est en moyenne 6% plus gros que celui des femmes, c’est simplement parce que les hommes sont en moyenne plus grands. Les proportions de matière grise et blanche sont exactement les mêmes d’un cerveau neurotypique à l’autre. De plus, il est maintenant bien connu que ce n’est pas la taille d’une structure cérébrale qui pèse bien lourd dans la balance pour prédire ses capacités. C’est surtout la plasticité cérébrale qui a son rôle à jouer, c’est-à-dire la façon dont les connexions neuronales vont être façonnées et évoluer en fonction des expériences de l’individu, de sa culture, de son histoire et de certains facteurs environnementaux. Les différentes études à ce sujet ne font pas encore consensus, mais nous savons maintenant que chaque personne est unique et que le sexe à la naissance ne fait pas le poids contre les variations individuelles!
Neuromythe #4 | Nous sommes condamnés à perdre nos capacités cognitives en vieillissant!
Certes, plusieurs fonctions cognitives diminuent avec l’âge : certaines de nos capacités commencent même à décliner dès la vingtaine ou la trentaine chez des personnes en bonne santé (Salthouse, 2009). Parmi celles qui sont particulièrement sensibles aux effets du vieillissement, on compte la vitesse de traitement de l’information, la mémoire de travail, certaines fonctions exécutives et l’efficacité de l’apprentissage de nouvelles informations.
Toutefois, certaines capacités cognitives dites « cristallisées » telles que nos connaissances générales et notre vocabulaire continuent à progresser jusqu’à au moins 60 ans, et demeurent assez stables jusqu’à 80 ans! Certaines habiletés comme la compréhension du langage et la mémoire procédurale sont également résistantes aux effets du vieillissement (Murman, 2015).
Et puis, certains facteurs ayant un impact sur le déclin cognitif peuvent être influencés par notre mode de vie (ex: sédentarité, pauvre qualité de sommeil, consommation de tabac et d’alcool, etc.) En fait, il est aussi tout à fait possible de conserver une excellente acuité cognitive, et ce, même au-delà de 100 ans! Bien sûr, plus on adopte tôt de saines habitudes de vie, et meilleures sont nos chances de vivre longtemps en bonne santé cognitive et de manière autonome… Mais il n’est jamais trop tard pour commencer!
Neuromythe #5 | Ça ne peut pas être « juste » de l’anxiété!
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, de pauvres performances cognitives peuvent bel et bien être causées… uniquement par l’anxiété. En effet, les critères diagnostiques de certains troubles anxieux (tels que le trouble d’anxiété généralisée) incluent des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions. Or, ces signes cliniques sont aussi ceux du TDAH où l’on retrouve également un niveau de distractibilité élevé et des difficultés d’organisation et de planification. Une personne étant particulièrement préoccupée ou stressée peut ainsi être susceptible d’être affectée par l’intrusion de ses pensées et de ses inquiétudes, la rendant moins apte à accomplir certaines tâches. Et le trouble d’anxiété généralisée, tout comme les difficultés de régulation émotionnelle d’une personne peuvent donc bien être la seule cause affectant les capacités d’une personne à mobiliser ses ressources cognitives!
Alors, y a-t-il des neuromythes auxquels vous croyiez encore dur comme fer avant d’avoir lu cet article? Si oui, on vous encourage à le partager avec votre entourage, car oui, il est temps d’en finir avec ces idées reçues! Et n’hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires ci-dessous si vous avez un doute sur un potentiel neuromythe : nous serons heureux de vous répondre.



